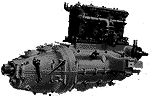PANHARD & LEVASSOR
1902
Note �crite de la main de Krebs
Archives Panhard
Note sur l'origine de la Soci�t� Anonyme des Anciens
�tablissements Panhard et Levassor (Salon 1902)
_________________________
Origines
de la soci�t�
La Soci�t� Anonyme des Anciens �tablissements Panhard
et Levassor recueillait en 1897 l'h�ritage d'une Maison dont les
�tats de service dans la m�canique �taient d�j�
brillants.
C'est P�rin, l'inventeur de la scie � ruban, qui cr�a,
vers 1846, la Maison qui devait �tre plus tard la Soci�t�
Panhard et Levassor. Son atelier �tait consacr� �
la construction de la machine � bois et en particulier de la scie
dont il �tait l'inventeur.
La raison sociale de la Maison a �t� :
en 1846 P�rin
1867 P�rin Panhard
1872 P�rin Panhard et Cie
1886 Panhard et Levassor
1897 Soci�t� Anonyme des Anciens
�tablissements Panhard et Levassor.
D�s l'origine, la Maison n'a cess� de s'attacher �
obtenir la fabrication la plus irr�prochable, condition indispensable
pour les machines � bois qui comportent g�n�ralement
des pi�ces anim�es de mouvements tr�s rapides.
Construction
des premiers moteurs � gaz et des premiers moteurs � p�trole
Ces habitudes de pr�cision dans le travail, ont amen� cette
Maison � s'occuper de la construction des moteurs � gaz d�s
les ann�es 1875. Bient�t, apr�s 1886, elle entreprenait
la construction des moteurs � essence dont elle avait achet�
les brevets � M. Daimler de Carnstadt.
Cr�ation
de la premi�re voiture automobile
En 1891 la Maison Panhard r�alisait la premi�re voiture automobile
mue par moteur � p�trole, gr�ce � la pers�v�rante
�nergie de l'un de ses chefs, le regrett� �mile Levassor.
Elle peut donc �tre consid�r�e � juste titre
comme le berceau de l'industrie automobile.
Cr�ation
des diff�rentes dispositions adopt�es maintenant par tous
les constructeurs
Depuis que la premi�re voiture automobile est sortie des ateliers
Panhard Levassor, chaque ann�e a �t� marqu�e
par de nouveaux progr�s, dont l'ensemble, adopt� par tous
les constructeurs, constitue le type qui est universellement connu sous
le nom de type fran�ais apr�s avoir �t� simplement
le type Panhard.
Ce type est caract�ris� par les points suivants :
- Moteur � l'avant
- Roues en bois
- Volant de direction
- Levier de changement
de vitesse
- Position du radiateur
- Disposition g�n�rale de la transmission
du mouvement
- Chassis en bois
arm�.
Chacune
des �tapes franchies, chacun des progr�s r�alis�s,
a re�u sa cons�cration dans les grandes �preuves
sportives auxquelles les voitures de la Soci�t� ont pris
part.
1895 Paris - Bordeaux - Paris (endurance)
1896 Paris - Marseille - Paris (endurance)
1897 Paris - Dieppe (1er emploi du radiateur)
1898 Paris - Amstrerdam (direction par volant irr�versible,
�quilibrage des moteurs � quatre cylindres)
1899 Paris - Bordeaux (radiateur � l'avant)
1899 Tour de France (frein � m�choires sur
le diff�rentiel)
1900 Paris - Toulouse (changement
de marche sans d�placement de pignons d'angle)
1901 Paris - Berlin (moteurs sans joints � la
culasse, suspension du m�canisme en trois points)
1902 Paris - Vienne (moteurs � cylindres en acier
extra l�ger, emploi
de l'acier au nickel, frein sur roues serrant avant et arri�re).
Dans toutes ces �preuves la Soci�t� Panhard Levassor
s'est efforc�e de conserver la sup�riorit� par la
bonne conception et la bonne ex�cution de ses voitures et non par
l'emploi de moteurs d'une puissance exag�r�e.
Parmi les perfectionnements qui ont marqu� chacune des �tapes
ci-dessus et dont la plupart ont fait l'objet de brevets pris par la Soci�t�
Panhard Levassor (liste g�n�rale en annexe), nous appellerons
tout particuli�rement l'attention sur les points suivants :
La
direction irr�versible dont l'emploi est devenu tellement
g�n�ral qu'il semble impossible de faire maintenant une voiture
automobile qui n'en soit pas munie, aussi bien en France qu'� l'�tranger.
L'�quilibrage
des moteurs � quatre cylindres et � deux cylindres.
La
suspension du m�canisme par trois points (brevet du 14 janvier
1901).
Le
frein � m�choires sur le diff�rentiel qui a
�galement constitu� un progr�s faisant �poque
(brevet du 16 d�cembre 1898).
Les
moteurs � cylindres en acier (brevet du 23 octobre 1901).
Choix
des mat�riaux - m�thodes d'essai
Pendant que ces dispositions nouvelles �taient cr��es,
des perfectionnements constants �taient apport�s dans la
fabrication, dans le choix des mat�riaux, la bonne ex�cution
du travail et la conception de l'ensemble et des d�tails.
Les premi�res voitures avaient �t� �tablies
dans les conditions ordinaires en usage dans la m�canique ; la puissance
des moteurs n'�tant pas alors consid�rable il n'y avait aucune
difficult� � r�aliser la transmission du mouvement
dans ces conditions.
La puissance des moteurs devenant plus importante et les conditions de
l�g�ret� devant �tre respect�es, on a
d� avoir recours � des m�taux plus r�sistants
que ceux qu'on emploie habituellement.
La Soci�t� Panhard et Levassor, apr�s avoir �tudi�
avec le plus grand soin les r�sultats donn�s par la trempe
des aciers ordinaires, adoptait la premi�re les aciers au nickel
pour la fabrication des roues de vitesse et des vilebrequins (la premi�re
commande d'acier au nickel, adress�e � la Maison J. Holtzer,
remonte au 3 juin 1901).
Le choix de l'acier, et d'une mani�re plus g�n�rale,
des m�taux convenant le mieux � toutes les parties de la
voiture, a �t� fait � la suite de nombreux essais
de r�sistance et en particulier d'essais au choc, ex�cut�s
d'apr�s les m�thodes les plus nouvelles. La Soci�t�
Panhard et Levassor a �t� la premi�re (dans l'industrie
automobile) � l'employer en essais pour se guider dans le choix
des m�taux � employer et pour �tudier le traitement
qui convenait � ces m�taux. Nous croyons pouvoir affirmer
que personne avant elle n'avait fait usage de ces essais pour �tudier
la fragilit� des aciers durs.
Le service des essais de la Soci�t� comporte, en plus du
laboratoire d'essai m�canique, un laboratoire d'essais chimiques.
La Soci�t� Panhard et Levassor ne concevait l'application
d'un moteur de grande puissance � une voiture de course qu'�
la condition que ce moteur fut tout particuli�rement l�ger,
aussi a-t-elle �t� conduite la premi�re � employer
des cylindres en acier forg� avec enveloppe d'eau en laiton.
Elle a ainsi obtenu des moteurs de 60 chevaux nominaux (70 CV effectifs),
pesant seulement 4 kg par cheval effectif et des moteurs de 24 chevaux
nominaux (30 CV effectifs), pesant seulement 5 kg par cheval effectif.
Les moteurs de ce type qui ont eu un si brillant succ�s en 1902
entre Paris et Belfort �taient command�s � la Maison
Holtzer, en ce qui concerne les cylindres, d�s le 31 octobre 1901.
La construction de ces cylindres fait l'objet d'un brevet d�pos�
le 23 octobre 1901.
Nombreux
types de voitures r�pondant aux besoins vari�s de la client�le
En ce qui concerne les types de voitures, la Soci�t� Panhard
et Levassor n'a pas craint d'aborder un probl�me d'une extr�me
difficult� : constituer, au moyen d'un nombre restreint de pi�ces
interchangeables, un nombre consid�rable de types satisfaisant �
toutes les demandes.
Ce r�sultat a �t� obtenu de la fa�on la plus
compl�te. L'acheteur qui se pr�sente dans les bureaux de
la Soci�t� peut choisir entre des voitures de huit puissances
diff�rentes, variant de 5 � 60 chevaux, et pour chacune des
puissances, entre 40 solutions parfaitement d�finies et r�pondant
� tous les types de carrosseries.
Nous croyons devoir insister sur ce point, qui constitue l'une des principales
forces de la Maison et qui n'a �t� obtenu qu'en apportant
dans les �tudes et le travail beaucoup d'ordre et de m�thode.
L'ex�cution des pi�ces n'a pas �t� moins bien
coordonn�e que la conception des types de voiture, l'interchangeabilit�
�tant obtenue par l'emploi de machines perfectionn�es munies
de montages �tudi�s et �tablis par la soci�t�
et assurant la bonne ex�cution ind�pendamment de l'habilet�
de l'ouvrier.
Enfin cette importante fabrication (actuellement 120 voitures par mois)
est contr�l�e par un service de v�rification sp�cial
compl�tement ind�pendant de l'atelier et auquel chaque pi�ce
est soumise apr�s chaque �tape de formation subie.
Nouveaut�s
pr�sentes au Salon de 1902
Les nouveaut�s pr�sent�es par la Soci�t�
Panhard et Levassor au Salon de 1902 sont d�crites succintement
dans la note A et les dessins qui y sont joints.
Nous nous permettons cependant d'attirer l'attention du Jury sur les points
suivants :
Nous consid�rons que le
carburateur automatique constitue une am�lioration extr�mement
importante et tout � fait nouvelle. Depuis que nous avons r�alis�
cet appareil et appel� le public � constater la fa�on
dont il fonctionne, on nous a signal� de nombreux efforts d�j�
faits en vue d'obtenir le m�me r�sultat. L'existence de ces
diff�rents essais ne nous surprend nullement car nous avions nous-m�me
fait ant�rieurement des essais analogues qui n'avaient pas eu de
suite, les r�sultats n'�tant pas plus concluants que ceux
obtenus par nos concurrents. La raison en est que la solution entrevue
ne pouvait �tre r�alis�e qu'� la suite d'une
�tude absolument compl�te et rationnelle des ph�nom�nes
tr�s d�licats qui se produisent dans le carburateur pendant
les changements d'allure du moteur. Cette �tude fait l'objet de
la note B, pr�sent�e � l'Acad�mie des Sciences
dans la s�ance du 22 novembre 1902.
Les exp�riences auquelles le public peut assister journellement
au grand Palais, depuis l'ouverture de l'Exposition, prouvent surabondamment
que le r�sultat est obtenu.
Importance
de la Soci�t� Panhard et Levassor
Les bonnes traditions de travail et de loyaut� de la Soci�t�
Panhard et Levassor lui ont attir� les sympathies d'une nombreuse
client�le ; aussi son chiffre d'affaires s'�l�ve-t-il
annuellement � plus de quatorze millions de francs. Les affaires
qu'elle fait avec l'�tranger peuvent �tre �valu�es
� un tiers de son chiffre d'affaires.
La Maison a construit actuellement plus de cinq mille voitures et voit
revenir p�riodiquement dans ses ateliers de r�paration les
plus anciennes voitures sorties de ses ateliers. Toutes ces voitures font
un service r�gulier et ont conserv� une valeur marchande,
c'est l� une r�clame pour ainsi dire vivante qui la dispense
d'en faire d'autres.
Ainsi la Soci�t� vient-elle d'�tre oblig�e de
construire, � proximit� de ses ateliers de construction,
des ateliers de r�paration qui occupent une superficie de 7000 m�.
Ateliers qui sont l'objet de la plus grande sollicitude car c'est l�
que les dispositions nouvelles sont jug�es en dernier ressort. C'est
l� aussi qu'on trouve souvent l'inspiration de dispositions �
adopter pour l'avenir.
La Soci�t� construit aussi des moteurs fixes pour groupes
�lectrog�nes aux usages divers et des bateaux actionn�s
par ses moteurs. Elle a remport� dans cette branche d'industrie
de nombreux succ�s.
Enfin elle fait aussi l'application de ses moteurs au mat�riel l�ger
pour chemins de fer.
La Soci�t� continue d'ailleurs la fabrication des machines
� bois et des lames de scies.
Brevets
principaux pris par la Soci�t� Anonyme des Anciens �tablissements
Panhard Levassor
------------------------------------
21 d�cembre 1897
Perfectionnement aux embrayages par l'introduction
sous les l�vres de cuir de ressorts faisant varier progressivement
l'effort d'entra�nement.
16 d�cembre 1898
Moteur � p�trole avec r�glage
sur l'admission par le moyen d'un boisseau ou d'une valve command�
par le r�gulateur.
11 novembre 1899
Changement de vitesse et de marche supprimant
le d�placement des engrenanges coniques employ�s jusqu'alors
pour obtenir la marche avant ou arri�re.
5 mai 1900
Pompe rotative de petite dimension �
grand d�bit avec dispositif pour r�cup�rer une grande
partie de la force vive.
7 juillet 1900
Syst�me de r�gulateur de
vitesse agissant sur l'admission par �tranglement des gaz aspir�s
et proportionnant la puissance des coups de piston � la r�sistance
de la voiture.
21 juillet 1900
Moteur � explosion d�nomm�
"Centaure" avec r�glage sur l'admission. Tous les organes tr�s
simplifi�s de ce moteur sont enferm�s dans un carter sauf
le r�gulateur.
14 d�cembre 1900
Syst�me d'embrayage � c�ne
avec tores d'entra�nement supprimant le glissement longitudinal sur
l'arbre command�. Cette disposition r�duit dans une tr�s
large proportion l'effort n�cessaire pour produire l'embrayage.
8 janvier 1901
Syst�me d'�quilibrage des
moteurs � deux cylindres. Le proc�d� consiste �
cr�er un couple d'inertie �gal et contraire au couple produit
par l'ensemble des bielles et manivelles. La formule �tablie dans
la description du brevet donne la solution g�n�rale. Dans
le cas particulier, le couple antagoniste est cr�� en partie
par suppression de masse et donne la solution la plus l�g�re.
14 janvier 1901
Suspension par trois points. Cette disposition
soustrait le m�canisme aux d�formations �lastiques
que subit toujours le ch�ssis de la voiture pendant le roulement
; elle supprime deux articulations et diminue les frottements de 8 �
10%.
23 octobre 1901
Perfectionnements aux moteurs "Centaure"
pour obtenir des moteurs l�gers. Emploi des cylindres en acier avec
enveloppes d'eau rapport�es, etc.
16 novembre 1901
Appareil de distribution du courant primaire
pour l'allumage �lectrique. Les contacts sont obtenus au moyen de
balais m�talliques enferm�s dans une bo�te et compl�tement
� l'abri de la pluie, de la boue et de la poussi�re.
22 f�vrier 1902
Freins m�talliques pour roues d'arri�re
fonctionnant dans les deux sens de marche.
24 f�vrier 1902
Syst�me de graissage par pompe
actionn�e par les gaz d'�chappement supprimant tout m�canisme
reliant la pompe au moteur.
26 mars 1902
Syst�me d'essieu et de ressort
pour avant-train de v�hicules automobiles.
25 juin 1902
Soupapes d'aspiration command�es
par cames extensibles permettant de r�gler � volont�
le volume aspir� par les cylindres et par suite de ne conserver
de compression que ce qu'il faut pour permettre l'allumage. La mise en
route d'un moteur puissant est ainsi rendue tr�s facile.
Carburateur automatique (voir notes A et
B).
Radiateur � courant d'ai forc�
et r�servoir r�duit (note A).
Nouvel appareil de graissage (note A).
Appareil de contr�le de la vitesse
des moteurs (note A).
|